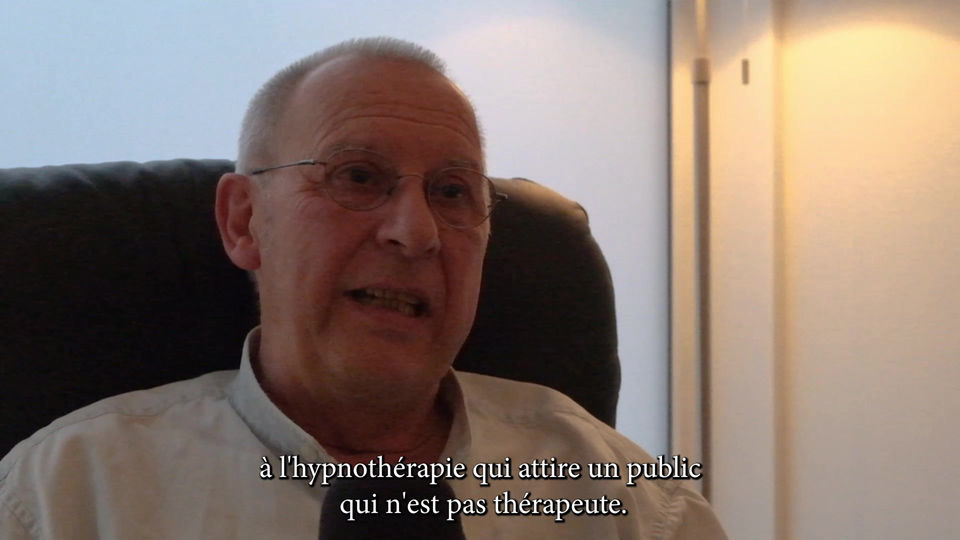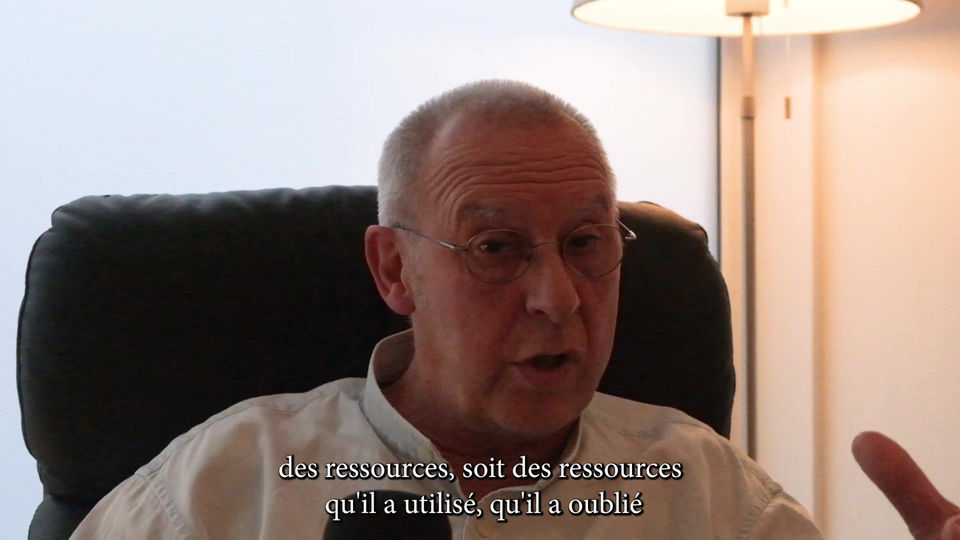Santé : les centres de désintoxication français sont-ils efficaces face à l’addiction médicamenteuse ?

@Marin Prévôt - Hôpital Foch, rangement Tramadol de la pharmacie du secteur de jour
Devenir addict aux antidouleurs à cause de simples maux de crâne, c’est possible.
Morphine, codéine, tramadol : plus de 200.000 français font face à l’addiction médicamenteuse chaque année. « L’accessibilité » de certaines molécules psychoactives en vente dans nos pharmacies rend difficile l’étape de sevrage. Les aides proposées par l’Etat sont multiples, mais nombreux sont ceux qui s’en écartent pour différentes raisons (méfiance, crainte du jugement, doutes de l'efficacité). Les méthodes des centres de désintoxication sont-elles efficaces dans le cas de l’addiction médicamenteuse ?
Les Français font partie des plus gros consommateurs de médicaments dans le monde. En 2019, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) publie l'état des lieux de la consommation en France des antalgiques opioïdes.
Pour rappel : un opioïde est une substance psychotrope de synthèse ou naturelle dont les effets sont similaires à ceux de l'opium sans y être chimiquement apparentés.
L’étude révèle qu’environ 12 millions de français ont eu une prescription de ce type de médicament (soit 17,9% de la population), dont 1 million traité par opioïdes dits « forts ». En tête des prescriptions : le tramadol. Sa consommation seule ou en association a augmenté de 68 % entre 2006 et 2017. Il remplace le Di-Antalvic, retiré de la vente en 2011 en raison de nombreux décès par intoxication (ANSM). À la seconde place, on retrouve les médicaments à base de codéine qui comptaient en 2017 près de 8 doses journalières pour 1000 habitants en France, un nombre qui ne cesse d’augmenter.
Le problème est le potentiel psychoactif de ces médicaments, dits psychotropes. Ils modifient certains processus biochimiques et physiologiques du cerveau et ouvrent donc les portes aux comportements addictifs.
1 adolescent sur 4 a déjà pris un médicament psychotrope hors prescription. C’est ce que révèle l’Observatoire Français des drogues et des toxicomanies (OFDT) dans « Jeunes et médicaments psychotropes : Enquête qualitative sur l’usage détourné » de 2014.
Un chiffre qui aurait largement augmenté aujourd’hui selon le site d’information et de soutien Addict’AIDE. Le nombre d’hospitalisation lié à la consommation de ces médicaments a connu une hausse de 167 % entre 2000 et 2017 (selon l’ANSM). Ainsi, en 2019, c’est près de 450 personnes qui décèdent des suites d’une overdose d’opioïdes.
Ce chiffre est quatre fois supérieur à celui de personnes décédées d’une overdose de cocaïne en 2019. En 2015, 463 jeunes de 15 ans ou moins ont perdu la vie des suites d’une consommation abusive de stupéfiants et médicaments opiacés provoquant troubles du comportement, accidents, suicides et overdoses (source CépiDC-Inserm).
Tout le monde peut tomber dans l'addiction aux opioïdes
« Aujourd’hui, il y a plus d’overdoses chez les patients avec des douleurs chroniques que chez les consommateurs de drogue », s’alarme Nicolas Authier, président de l’Observatoire français des médicaments antalgiques (OFMA). « Ce n’est pas une problématique spécifique des usagers de drogue. On parle ici de femmes (60 %) et d’hommes de 40, 50, 60 ans, sans antécédents de prise de drogue », ajoute-t-il. L’enquête de l’OFDT permet de distinguer deux contextes

menant à des usages détournés de médicaments psychotropes. La première, à la suite d’une hospitalisation ou prescription médicale et la seconde dans le cadre d’une volonté d’expérimentation récréative. L’accoutumance aux médicaments est presque un tabou dans le milieu hospitalier, malgré le fait que le risque soit bien réel.
« L’addiction médicamenteuse, c’est quelque chose qui va arriver en second plan dans l’ordre des priorités du
soin », explique Laura, étudiante en institut de formation aux soins infirmiers (IFSI). « On va parfois pousser à prescrire des doses plus importantes pour soulager la douleur, même si on prend le risque de rendre ce patient addict aux médicaments », conclut-elle.
Mais parfois, un simple traitement peut faire basculer la vie d’un patient. C’est le cas de Clément, 29 ans, qui devient addict à la codéine après un traitement prescrit par son chirurgien dentaire. « Ma première erreur, c’est d’avoir répondu négativement à la question “Avez-vous des allergies ou des réactions à certaines molécules ?“ au lieu de dire que je n’en avais aucune idée », dit-il. Clément parle de son traitement comme un cycle chaotique entre réveils de la douleur et véritables comas "apaisants" suite à la prise du médicament. À partir d’une ordonnance, certains jeunes pratiquent des formes d’automédication.
Témoignage de Clément
Portrait clé de mon enquête :
ancien addict sevré de codéine, cocaïne et héroïne.
Toujours dans un objectif thérapeutique, ces adolescents modifient la fréquence des prises et les dosages, avec par la suite un développement plus ou moins marqué des symptômes d’addiction. Certains médicaments sont aussi associés à d’autres substances : les usages dérivés. « Avant chaque soirée, mes amies et moi on buvait notre verre de lean », confie Andréa, 26 ans. Il y a quelques années encore, pendant ses études, elle consommait ce mélange de soda et de sirop codéiné pour ses effets désinhibants. Problème, elle commence à consommer la lean de plus en plus fréquemment. Ses actifs apaisants et déstressants lui permettent le soir de réviser plus tardivement et de mieux gérer son anxiété. L’enquête ESCAPAD 2017 de l’OFDT dévoile que 8,5% des jeunes de 17 ans ont déjà fait usage de la lean (sachant que l’enquête s’est déroulée avant l’arrêté du 12 juillet 2017 retirant tous les médicaments contenant de la codéine du libre-service).
Une haute surveillance, avec ses limites
« Avant, c’était vraiment des marginaux. Aujourd’hui ça peut être n’importe qui », affirme Mr Chaulet, pharmacien en banlieue parisienne. « Nous sommes les gardiens du poison, on doit pouvoir détecter si c’est un traitement pour le bien de la personne ou pour répondre à son addiction ». L’arrêté du 12 juillet 2017 ne diminue pourtant pas les chiffres de l’addiction médicamenteuse. L’augmentation du nombre de prescriptions en serait la cause. « C’est vrai qu’aujourd’hui, le médecin prescrit facilement un antidouleur à base de codéine. On ne se pose pas forcément la question du risque d’addiction au moment de la délivrance du médicament », conclut le pharmacien. Pour autant, les Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance - addictovigilance (CEIP-A) renforcent constamment la surveillance des antalgiques

@Marin Prévôt - Antidouleurs ©Klipal Codéine
opioïdes. Dans la feuille de route 2019-2022 Prévenir et agir face aux surdoses d’opioïdes, le ministère de la solidarité et de la santé liste les dispositifs de surveillance existants : « les dispositifs de l’OFDT (…) renseignent sur l’évolution des tendances et phénomènes émergents (TREND), sur la nature des produits circulants sur le territoire (SINTES) et sur les cellules de veille et alerte en ARS (Agence Régionale de Santé) ». Dans un but de mieux encadrer la prise de ces molécules, les pharmaciens sont aussi les premiers à être rappelés à l’ordre : « On reçoit très fréquemment des mises en garde de l’Ordre National des Pharmaciens. En septembre 2021, nous avons eu un communiqué sur l’appel à la vigilance par rapport au Trafic de médicaments comprenant quatre rappels : le contrôle de la conformité de la prescription, être attentif au comportement du porteur, faire l’analyse pharmaceutique et prendre contact avec le prescripteur en cas de
doute », ajoute Mr Chaulet.
« Evidemment que des méthodes permettent d’échapper à la surveillance », affirme Claire Sibenaler, ancienne présidente du LEEM (l’organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France). « La digitalisation du monde médical, par les ordonnances numériques et par l’achat des médicaments via internet, ainsi que le marché noir, sont des axes de contournement de la pharmacovigilance », ajoute-t-elle. En 2019, la saisie de médicaments en Europe provenant du marché noir était de 36 millions de cachets, soit trois fois plus que l’année précédente (source : Gendinfo).

@Marin Prévôt - Couloir du secteur Addictologie de l'hôpital Foch
Clément, ancien addict : « Je ne voulais pas qu’on m’aide… »
Dans la suite du processus d’addiction, il y a la prise de conscience du comportement addictif. Même si elle peut se faire par le patient lui-même, chez les jeunes, elle est plus fréquemment détectée par les parents. « À l’époque, ce sont mes parents qui m’avaient posé simplement la question, et comme un gamin qui a fait une connerie, je suis devenu tout rouge et ils ont compris », me confie Clément. Vouloir se faire aider, cela peut paraître simple, mais c’est la première montagne à franchir pour les addicts dans le processus de sevrage. Addict’AIDE est un portail d’information gratuit permettant un échange entre patients et professionnels. Cette plateforme permet aussi de réaliser un test pour déterminer à quel stade de la maladie on se trouve. En fonction des résultats, le patient est dirigé vers des informations ciblées ainsi que des professionnels de santé en mesure d’apporter des solutions. Le forum est géré par l’association France Patients Experts Addictions : des anciens addicts échangent avec les malades. « Lorsqu’on parle des jeunes, ce sont principalement les parents qui prennent contact avec nous par le forum. Un adolescent ne va pas se rendre compte de la gravité de son comportement et des conséquences que ça peut avoir. Il n’entendra pas que c’est un problème jusqu’à ce que ça aille vraiment mal », affirme Sami Amri, chef de projet éditorial sur la plateforme. « La deuxième erreur que j’ai commise dans cette période de ma vie, c’est d’aller en centre de désintoxication pour faire plaisir à mes parents et pas dans une volonté personnelle de me soigner. C’était deux semaines insupportables durant lesquelles j’attendais la sortie pour reprendre là où je m’étais arrêté », me confie Clément.

La cure de désintoxication : un médicament contre les médicaments
En France, il existe plusieurs types de structures pour effectuer une cure de désintoxication. Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), les Centres de Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR), les services d’addictologie des hôpitaux publics et enfin les cliniques privées. Lors d’une prise en charge en CSAPA, CSSR ou à l’hôpital public, la cure de désintoxication sera alors remboursée en partie par l’Assurance maladie.
Selon l’étude Bon usage des antalgiques opioïdes. Prévention et prise en charge du mésusage et des surdoses d’opioïdes de la Haute Autorité de Santé en 2016, les CSAPA ont accueilli près de 45 000 personnes pour leur consommation d’opioïdes. Il faut souligner que pour l’ensemble des patients vus dans les CSAPA, l’alcool apparaît comme le premier facteur d’addiction pour près de la moitié des patients, le cannabis pour 20 %, les opioïdes pour 15 %, et le tabac pour 7 %.
La compétence de ces centres n’est plus à prouver lorsqu’on parle de l’alcool ou d’autres drogues dures comme l’héroïne. Mais pour ce qui est des médicaments, c’est autre chose. La prise d’un médicament dans notre société est un geste devenu anodin. De manière générale, les principaux traitements utilisés en service de désintoxication sont la méthadone et la buprénorphine (©Subutex). Selon l’indication de l’AMM dans la Commission de la Transparence de 2007 de la Haute Autorité de Santé, la méthadone doit être utilisée dans le traitement de substitution des pharmacodépendances majeures aux opiacés.
Alors pourquoi utilise-t-on un médicament pour traiter l’addiction aux médicaments ? N'ayant pas eu l'accord de l'Assistance Publique des hôpitaux de Paris (APHP) pour tourner au sein de l'hôpital Fernand Widal, je me suis tourné vers le service d'addictologie semi-privé de l'hôpital Foch. « Le potentiel addictif de la méthadone est beaucoup plus faible que la molécule de base responsable de l’addiction », explique le docteur Faivre, médecin et addictologue au sein de l’hôpital Foch. « Cela permet d’espacer les prises de médicaments, de ralentir les effets de manque et d’aboutir dans une grande majorité des cas à un sevrage », ajoute-t-elle. Malheureusement, les molécules psychoactives sont toujours accessibles dans les pharmacies. Un patient sevré aura toujours ce risque de rechute au coin de la rue. Les premiers concernés sont les patients atteints de douleurs chroniques qui, malgré une cure de désintoxication, n’ont pas moins mal en sortant sevrés. C’est le cas de Laurent, 49 ans, directeur dans le conseil. Migraineux depuis son adolescence, il est tombé addict aux antidouleurs pendant une quinzaine d’années. Aujourd’hui, il contrôle sa consommation, mais son attitude face à la crainte de la douleur reste inchangée. « Je me comporte encore comme un drogué. J’achète mes médicaments en cash dans les pharmacies pour en avoir toujours d’avance. Même s’il faut une ordonnance, le monde nous apprend assez vite qu’on trouve toujours quelqu’un qui est prêt à vendre s’il n’y a pas de trace », déclare-t-il.
Témoignage complet de Laurent, 49 ans, addict aux antidouleurs depuis plus de 15 ans :
Malgré une période de cure, il semble difficile de sortir de l’addiction aux médicaments. « On ne sort jamais complètement de l’addiction aux médicaments », affirme le docteur Faivre. « Lors de l’addiction, la prise de médicament devient un besoin primaire comme la faim ou la soif. Le but de la cure est d’amener les patients dans une phase de rémission, pendant laquelle l’addiction ne se manifeste pas. Plus la période de rémission est longue, moins il y a de risque de rechute », conclut-elle.

@Marin Prévôt - Chambre d'hospitalisation de jour à l'hôpital Foch
Reportage : Service addictologie de l'hôpital Foch
Jérôme, addict aux opiacés : « Je ne sombre pas grâce aux réunions Narcotiques Anonymes »
Si le traitement de substitution marche pour beaucoup, il ne fait pas l’unanimité pour autant. Certaines personnes addictes se détachent des institutions conventionnelles de santé afin de se tourner vers des solutions alternatives de sevrage. L’association à but non lucratif Narcotiques Anonymes fait partie de ces solutions. Lors des réunions, chacun raconte son histoire. La majorité des participants sont des personnes addictes qui luttent encore contre leur dépendance. Ceux qui ont choisi d’être membre de l’association sont aidés par un parrain et suivent un programme en 12 étapes permettant un « éveil spirituel » (Le Carton Bleu - Narcotiques Anonymes France) grâce notamment à la méditation et à la prière.

« Les réunions c’est le seul endroit où je peux me dévoiler. Oui, je suis encore addict. Mais je ne sombre pas, grâce aux Narcotiques Anonymes », témoigne Jérôme, 26 ans, addict aux antidouleurs depuis 4 ans. « J’ai fait deux cures de désintoxication avant d’arriver ici il y a cinq mois. J’ai passé la première étape des 90 jours de sevrage avec l’aide de mon parrain. Mais j’ai rechuté. Retour à zéro. À mon arrivée il y a cinq mois, je suis parti avec l'idée que ça irait. Je me voyais déjà avec la médaille des un an. Mais pas du tout, c’est une lutte de tous les jours. Maintenant je sais que je dois respecter le programme pour m’en sortir ».
Dans ces réunions, la poly-consommation prédomine largement : en 2014, 88,5% des participants aux réunions consomment de l’alcool, 40% sont sous traitement de substitution (Méthadone, Subutex) et 62,2% sont consommateurs d’opiacés comme l’héroïne, morphine ou encore codéine (source : NA – Ça marche !).
@Marin Prévôt - Réunion des Narcotiques anonymes à l'hôpital Marmottant
Découverte d'une méthode alternative : l'hypnothérapie pour traiter l'addiction